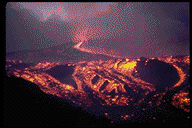
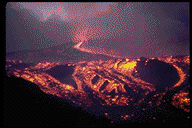
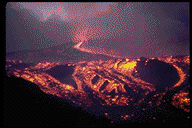
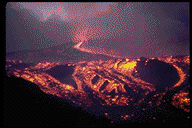
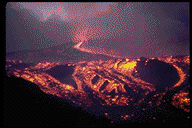 |
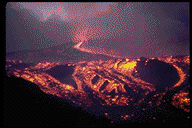 |
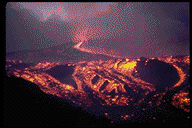 |
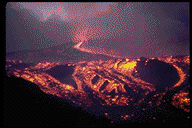 |
La première observation volcanologique, a moins de 2000 ans, elle provient de deux lettres de Pline le Jeune, avec la description de l’éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C., qui recouvrit d’un linceul de cendre les cités d’Herculanum, de Stabies et de Pompéi.
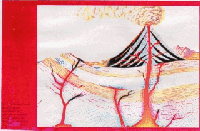 Mais les témoignages écrits et
exploitables sont très restreints dès que l’on remonte dans le temps. Pour
certains continents, comme l’Amérique, les récits d’éruptions
n’existent que depuis la colonisation. Les descriptions sont aussi parfois
trop succinctes pour être exploitables ou reprennent des témoignages
indirects. Ces écrits, quand ils existent ne concernent, le plus souvent, que
des volcans faciles d’accès.
Mais les témoignages écrits et
exploitables sont très restreints dès que l’on remonte dans le temps. Pour
certains continents, comme l’Amérique, les récits d’éruptions
n’existent que depuis la colonisation. Les descriptions sont aussi parfois
trop succinctes pour être exploitables ou reprennent des témoignages
indirects. Ces écrits, quand ils existent ne concernent, le plus souvent, que
des volcans faciles d’accès.
Les études montrèrent surtout que la durée d’existence d’un volcan,
peut être parfois de plusieurs millions d’années avec trois grandes
périodes :
Le terme de volcan actif n’est donc peut être
pas le plus approprié, et il faut plutôt parler de volcan vivant, celui
devenant mort quand sa dernière période de repos est plus grande que toutes
ses autres périodes de repos.
Le nombre en moyenne de volcan en éruption est d'environ une soixantaine par an. Ce nombre a même tendance à augmenter, car la Terre est de plus en plus surveillée par les satellites et des éruptions non observées sont maintenant comptabilisées. Des volcans sont en activité éruptive continue comme le Stromboli, le Kilauea, Soufriere Hills, le Yasur, l'Ambrym, l'Erta Alé, le Lengai.
EN 2001, les volcans qui sont entrés en éruption en plus de ceux cités précédemment sont :
Usu, Rotorua, Nyamuragira,
Nyiragongo, Villarica,
Piton de la Fournaise, Etna,
Ahyi, Ulawun, Galeras, Shiveluch (Kamchatka), Kliuchevskoi (Kamchatka),
Avachinsky (Kamchatka), Karymsky (Kamchatka), Bezymianny (Kamchatka),
Cleveland, Colima (Mexique),
Popocatepetl (Mexique), Santa Maria (Guatemala), Masaya
(Nicaragua), Mayon (Philippines), Manam (Papouasie-Nouvelle Guinée), Ulawun (Papouasie-Nouvelle
Guinée), Rabaul
(Papouasie-Nouvelle Guinée), Tungurahua (Equateur),
Guagua Pichincha (Equateur), Ruapehu
(Nouvelle-Zélande), White
Island (Nouvelle-Zélande), Merapi (Indonésie), Kerinci (Indonésie),
Semeru (Indonésie), Lokon-Empung (Indonésie), Krakatau
(Indonésie), Batur (Indonésie), Inielika (Indonésie), Makian (Indonésie),
Karangetang (Indonésie), Kick-’em-Jenny, San Cristobal (Nicaragua), Kavachi
(ïles Salomon), Suwanosejima (Japon), Kikai (Japon), Okmok
(ïles Aléoutiennes), Lopevi (Vanuatu),
Le nombre d'éruption est donc plus important, puisque pour un même volcan il peut y avoir au cours d'une année plusieurs éruptions.
http://perso.club-internet.fr/decobed/Etna.html
Le sommet de l’Etna comporte actuellement
quatre cratères ou bouches qui se sont ouverts au cours du siècle précédent
: le cratère Nord-Est (1911), le cratère central avec la Voragine (1945) et la
Bocca Nuova (1968), et le grand dernier : le cratère Sud-Est (1971). Ce dernier
cratère est dénommé depuis ses multiples phases paroxysmales de 1999-2000, le
cône Sud-Est. Le sommet, en l’occurrence le cratère Nord-Est, voit son
altitude se modifiée au gré des éruptions : 3 263 m en 1932 ; 3 295 m en 1956
; 3 323 m en 1964 ; 3 345 m en 1978, 3318 m en juin 1989 Mais il risque,
si l'activité au cône Sud-Est se maintient, d'être dépassé par le petit
dernier. Si les cratères montent en altitude ils
s’agrandissent également. Ainsi, la Bocca Nuova, qui n’était qu’un trou
de quelques mètres de diamètre lors de son ouverture, en 1968, est aujourd'hui
un cratère de plus de 300 m de diamètre. Dans un proche avenir le «
diaphragme », qui sépare la Bocca Nuova de l’autre cratère tout proche, la
Voragine, s’effondrera pour laisser place à un immense cratère central.
Ces quatre cratères sont "posés" sur un large
replat qui se trouve vers 2 900 m. Cette zone correspond à une caldeira , le
cratère elliptique, qui a été comblée par la succession des éruptions
sommitales.
 |
 |
Les éruptions
de l'Etna
Les géologues considèrent que l’activité historique de l'Etna débute avec
l'éruption de 122 av. J.-C et la formation du cratère del Piano.
Depuis, l'Etna a connu des centaines d'éruptions. On peut distinguer quatre
grands types d'éruptions :
 |
 |
|
 |
 |
peuvent engendrer des
tunnels de lave. Ces tunnels peuvent devenir un risque car ils
maintiennent toutes les propriétés rhéologiques de la lave à plusieurs
km du point d'émission. D'ailleurs
la lave quand elle sort de ces tunnels se présente avec une morphologie
de type pahoehoe, caractéristique d'une lave très fluide et très chaude
comme on peut l'observer à
Hawaii.
Nous prenons, comme exemple, deux éruptions très différentes
: l'éruption du 24 septembre 1986 et l'éruption de 1991-1992.
voir aussi le tableau des principales éruptions de l'Etna depuis le XVIIe siècle
: Tableau des
Eruptions de l'Etna.
L'éruption paroxysmale du 24 septembre 1986
En 1986, l'Etna était au repos, depuis le mois de
janvier, quand une nouvelle éruption débuta le 14 septembre dans le cratère
Nord-Est.
Pendant les premiers jours son activité attire de nombreux touristes.
— Le 23 septembre les volcanologues travaillant près du cratère ressentent et enregistrent de nombreux séismes inquiétants et observent l'intensification du phénomène explosif.Des bombes d'une tonne sont projetées à plus de 2 km d'altitude et retombent jusqu'à 3 km du sommet.
— Le 24 septembre au matin, la montagne montre une accalmie totale. En s'approchant, les volcanologues découvrent un changement important de la forme du cratère et de nombreuses fissures.
Ils préviennent les guides d'un risque éminent du changement d'activité et leur conseillent de ne plus s'approcher avec les touristes.
D'un seul coup, en fin de matinée, de la vapeur blanche commence à s'échapper du cratère.
— 12h30 on observe pendant 20 minutes un premier panache de cendres.
— 13h22 début d'une importante série d'explosions de cendres noires, qui durent chacune quelques minutes entrecoupées de phases de repos.
— 16h 47, les explosions deviennent beaucoup plus fortes et continues.
— 18h10 les bombes tombent à 300 m de la bouche d'émission ; les volcanologues s'enfuient pour se mettre en sécurité. (Cf. photos au-dessus)
— 18h30 les bombes montent à plus de 700 m de haut et retombent à 800 m du cratère.
— 18h45 la fontaine de magma s'élève à 1 000 m.
L'éruption latérale de l'Etna en 1991-1992
Après quelques mois de repos, l'Etna entre de nouveau en activité le 14 décembre 1991. Commençe la plus longue éruption de l’Etna du XXe siècle (473 jours).
— Le 15 décembre, une fissure s'ouvre à 2 300 m d'altitude sur les flancs du volcan dans la célèbre Valle del Bove. Une fracture, ayant la même orientation que celle de 1989, s’ouvre au pied du cratère Sud-Est ; successivement, à une altitude de 2 400 m, sur la paroi occidentale de la Valle del Bove, des bouches s'ouvrent et émettent des coulées de lave.Des hélicoptères de l’armée américaine tentent d'obstruer le tunnel de lave en amont. Une ouverture est alors réalisée dans la voûte du tunnel principal. Les hélicoptères déposent près du bord des blocs de béton d'une tonne. Ceux-ci sont ensuite enchaînés les uns aux autres. Puis les techniciens essayent de les faire tomber à l'intérieur du tunnel de lave pour le boucher.
— Le 17 décembre, les laves descendent jusqu'à 1 600 m.
— Le 25 décembre les coulées de lave menacent le village de Zafferana et son approvisionnement en eau.
Des bulldozers mettent en place des digues en terre afin de dévier la coulée et de protéger les habitations. La police installe des barrages pour décourager les curieux.
— Le 29 décembre. Le front de lave mesure 400 m de large et 10 m de haut. Une partie des structures d'approvisionnement en eau sont ensevelies. Des vergers sont menacés. On évacue quelques maisons isolées. Le débit journalier de la lave est estimé à 1 million de m3.
Les habitants de Zafferana s'inquiètent car la lave s'épanche de façon souterraine, dans des tunnels de lave ce qui conserve sa température et sa fluidité et lui permet de s'écouler très loin.
— Le 31 décembre elle descend jusqu'à 1 250 m d'altitude.Face à cette menace les autorités prennent la décision de construire une immense digue de terre.
— Le 3 janvier le front de lave descend jusqu'à 1 000 m.
En janvier et en février l'activité de l'Etna se maintient ; les coulées de lave s'écoulent toujours dans des tunnels de lave et ressortent un peu plus loin.
En mars, les coulées arrivent à 800 m d’altitude. Heureusement, elles se superposent et ne vont pas plus loin.
— Le 8 avril, la lave passe au-dessus du barrage construit durant le mois de janvier. Quelques jours plus tard la lave avance et, après avoir franchi d'autres barrages édifiés en toute hâte, atteint la côte de 750 m d'altitude.
— Le 9 mai la lave s'écoule rapidement et avance sur des vergers. Les habitants de Zafferana accusent l'état italien d'incompétences ; nous sommes en période électorale.
Les habitants d'un autre village, Milo, expriment leur mécontentement : ils ont peur que la coulée déviée descendent sur leur territoire. Les écologistes ont un autre avis, pour eux, lors d'une éruption la coulée de lave doit s'épancher naturellement sans aucune intervention de l'homme.
Les volcanologues imaginent d'autres moyens que les barrages et proposent d'endiguer la coulée à sa source. Des bulldozers essayent d'entamer le bord du tunnel, puis, des artificiers font sauter avec de la dynamite la paroi restante mais le chantier est perturbé par d'autres coulées de lave.