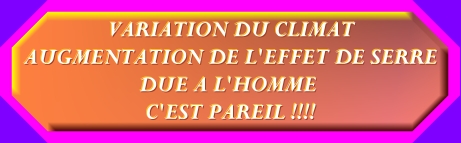
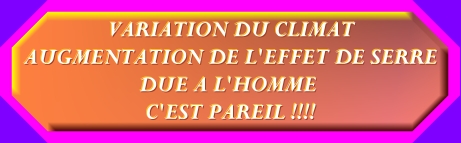
Dans le débat qui prend place autour de l'influence de l'homme sur le climat, il y a deux affirmations qui sont assez souvent faites, bien qu'elles soient inexactes :
dire que l'homme est devenu la seule cause de changement du climat,
dire que la seule action de l'homme sur le climat concerne l'augmentation de l'effet de serre.
Bien sûr, dire que ces affirmations sont inexactes ne signifie en rien que l'augmentation de l'effet de serre sous notre influence est une petite affaire, qu'elle n'a pas plus d'importance que nos autres actions sur le climat, ou encore qu'elle est négligeable devant les causes de variabilité naturelle.
Il n'en reste pas moins que l'homme peut agir sur le climat de bien des manières, tout comme le climat a aussi des facteurs de variation naturelle qui ne doivent rien à l'homme. Pouvons nous tenter d'y voir plus clair ?
En fait, non seulement le climat est capable de varier sans hommes pour le tripoter, mais sur de longues échelles de temps il n'a jamais cessé de le faire. Il y a bien des facteurs qui influent sur le système climatique terrestre, et si, par les temps qui courent, l'homme est devenu prépondérant, la liste des éléments qui jouent un rôle est longue :
le climat peut varier parce que la quantité d'énergie que le Soleil envoie sur la Terre varie. Cela même peut avoir plusieurs origines :
l'énergie fournie par la machine solaire peut varier. Il y a quelques milliards d'années, par exemple, cette énergie était de 30% inférieure à l'actuelle, car le Soleil était plus jeune. Aujourd'hui aussi l'énergie que nous envoie le Soleil varie en permanence. Il y a par exemple un cycle de 11 ans, caractérisé par la variation du nombre de taches solaires, au cours duquel l'énergie solaire augmente et diminue un peu.
Toutefois cette variation est faible, et n'explique pas le réchauffement récent
Sous l'influence de l'attraction des grosses planètes du système solaire, les paramètres astronomiques de la Terre ne sont pas constants au cours du temps. La distance moyenne au Soleil varie ("l'aplatissement" de l'ellipse que suit la terre autour du soleil est plus ou moins grand, avec une période de 100.000 ans, et l'énergie moyenne reçue dépend de cet aplatissement, c'est M. Kepler qui l'a dit !) ; l'inclinaison de la terre sur son orbite - que l'on appelle encore l'obliquité, voir dessin ci-dessous - varie (période de 40.000 ans environ), et enfin la terre ne présente pas toujours le même hémisphère quand elle est au plus près du Soleil (période 26.000 ans environ). Tout cela a pour conséquence que la quantité d'énergie solaire reçue, et surtout la manière dont elle se répartit sur la Terre, se modifient un peu au cours des temps.
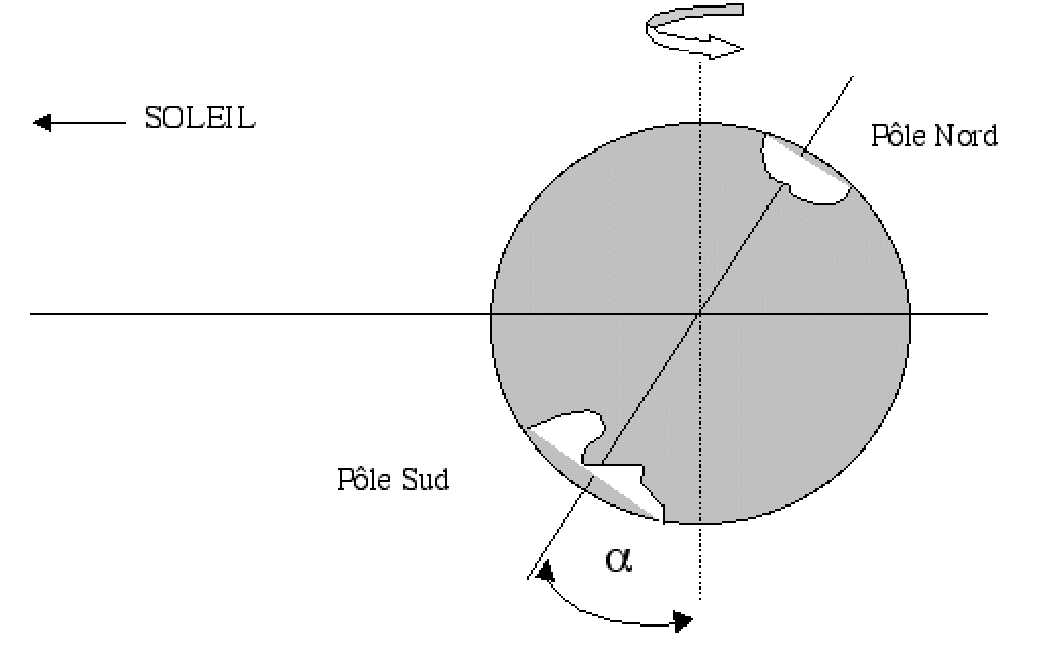
L'obliquité correspond à l'angle alpha en bas du dessin. La precession des équinoxes est matérialisée par la grande flèche en haut : elle désigne le fait que l'axe de rotation de la terre "tourne" autour de la ligne verticale qui matérialise la perpendiculaire au plan de l'orbite terrestre.
Ces variations astronomiques ont gouverné au premier ordre le cycle des glaciations sur les dernières centaines de milliers d'années.

Evolution, sur les 400.000 dernières années, de la température moyenne de Antarctique. Le 0 de l'axe vertical de droite correspond à la valeur actuelle (cette courbe montre donc les écarts à la valeur actuelle). Cette variation de température est légèrement plus élevée que celle de la planète dans son ensemble. Source : Petit & al., Nature, Juin 1999
Attention ! cette courbe se lit à l'envers : plus on va vers la droite, plus on remonte dans le temps. Le fait que les oscillations soient plus importantes à gauche (donc récemment) tient à la meilleure précision des mesures quand on se rapproche de l'époque contemporaine.
le climat peut varier par suite d'une modification de la composition de l'atmosphère (sans intervention de l'homme), ce qui peut changer l'effet de serre. Par exemple, l'apparition de la vie a fait considérablement baisser, en quelques centaines de millions d'années, la teneur en gaz carbonique dans l'air (le CO2 était l'un des constituants majoritaires de l'atmosphère primitive), ce qui a graduellement diminué l'effet de serre au cours de cette période (il se trouve que parallèlement l'activité solaire a augmenté, et que les deux processus se sont à peu près compensés).

Concentrations de CO2 au cours des âges géologiques récents. RCO2 est le rapport entre la concentration pré-industrielle en CO2 (qui faisait un peu moins de 300 parties par million, soit 0,03% de l'atmosphère en volume) et celle existant dans le passé. Par exemple R = 5 signifie que la concentration est alors de 5*300 = 1500 ppm, ou encore que le CO2 occupe alors 0,15% de l'atmosphère.
A l'époque des dinosaures (-230 millions d'années à - 65 millions d'années) l'atmosphère avait de 2 à 5 fois plus de CO2 qu'à l'époque pré-industrielle, et donc l'effet de serre était plus important (mais l'activité solaire était plus faible, de telle sorte que la température moyenne de la planète n'était pas considérablement au-dessus de l'actuelle). Et surtout cette courbe ne dit pas ce qui se passe quand le CO2 est multiplié par 2 à 4 en un siècle, ce qui n'est jamais arrivé naturellement !
Source : Berner, Science, 1997, repris sur Planète Terre
le climat peut varier en fonction de l'activité volcanique. Une éruption volcanique envoie dans l'atmosphère du SO2 (qui est un "refroidisseur du climat", voir page sur les aérosols), peut y mettre du CO2, qui est un gaz à effet de serre, et si l'éruption est assez violente elle peut envoyer dans la stratosphère (une couche de l'atmosphère qui débute à 10 km du sol environ) des poussières qui obscurcissent un peu la lumière du soleil, et vont rester "en l'air" très longtemps (quelques mois ou années). L'une des théories pour expliquer la disparition des dinosaures, par exemple, a longtemps été une activité volcanique si intense qu'elle aurait obscurci le ciel en mettant des quantités considérables de poussières dans la stratosphère, ce qui aurait significativement refroidi la Terre et fait périr quasiment toutes les espèces à l'époque. En fait l'hypothèse qui tient la corde aujourd'hui est l'impact d'un météorite, qui aurait eu à peu près le même effet (plein de poussières dans la stratosphère), mais cela illustre qu'un changement climatique majeur peut déboucher sur une crise massive d'extinctions.
sur de très longues périodes, le climat varie en fonction de la dérive des continents :
c'est l'installation d'une plaque continentale au Pôle Sud qui a permis l'apparition d'une calotte polaire permanente, ce qui a un effet sur le climat planétaire dans son ensemble,
La dérive des continents influe sur la forme des bassins océaniques, ce qui en retour peut modifier le parcours des courants marins, qui transportent plus ou moins d'énergie des tropiques vers les pôles.
La dérive des continents a aussi créé des chaînes de montagnes, qui ont assurément une influence locale importante sur le climat !
Le climat varie en fonction du pouvoir réfléchissant de la Terre, qui conditionne la quantité d'énergie solaire qui repart vers l'espace sans avoir été exploitée par la machine climatique. Ce pouvoir réfléchissant - que les physiciens appellent "albedo" - augmente avec l'étendue globale de la glace sur terre (par exemple de la banquise), augmente avec la désertification (naturelle ou pas), mais diminue quand une forêt apparaît à la place d'une savane ou prairie (les forêts sont des surfaces généralement peu réfléchissantes, sauf les forêts boréales en hiver, couvertes de neige).
Il est donc certain que l'homme n'est pas le seul facteur de variation du climat, mais la question est : va-t-il désormais être le principal sur les siècles qui viennent ? Et là la réponse est que probablement oui.....