

![]() Comme les cratères sont difficiles
d'accès et d'approche, les géologues ont étudié les appareils volcaniques
anciens, érodés au cours des temps, pour essayer de comprendre ce qu'est un volcan.
Comme les cratères sont difficiles
d'accès et d'approche, les géologues ont étudié les appareils volcaniques
anciens, érodés au cours des temps, pour essayer de comprendre ce qu'est un volcan.
![]() On sait qu'un volcan
est formé de trois parties : un réservoir de magma
en profondeur, une ou des cheminées volcaniques qui font communiquer l'intérieur
de la Terre avec la surface, et enfin, la montagne volcanique, qui est soit un
cratère, soit un cône à cratère, un dôme, une coulée de lave ou un dépôt
de produit d'explosion (nappes de ponces,
etc.).
On sait qu'un volcan
est formé de trois parties : un réservoir de magma
en profondeur, une ou des cheminées volcaniques qui font communiquer l'intérieur
de la Terre avec la surface, et enfin, la montagne volcanique, qui est soit un
cratère, soit un cône à cratère, un dôme, une coulée de lave ou un dépôt
de produit d'explosion (nappes de ponces,
etc.).
![]() Un même volcan
peut possèder plusieurs réservoirs de magma.
On a cru que ces chambres de roche en fusion se situaient à de très grande
profondeur, des milliers de kilomètres sous la surface de la Terre. Les
scientifiques ont prouvé que ceux-ci sont beaucoup plus superficiels.
Un même volcan
peut possèder plusieurs réservoirs de magma.
On a cru que ces chambres de roche en fusion se situaient à de très grande
profondeur, des milliers de kilomètres sous la surface de la Terre. Les
scientifiques ont prouvé que ceux-ci sont beaucoup plus superficiels.
![]() C'est par les cheminées ou conduits
que la roche en fusion arrive jusqu'à la surface. Ce que nous pouvons
appercevoir est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé dans un réservoir
par la fusion de roches, s'est continué par la monté de ces magmas
chargés en gaz, avant de se terminer par l'arrivée de ces matières à la
surface. Ce que nous appelons "volcans"
n'est que l'appareil naturel, qui fait communiquer les zones profondes et la
surface de la Terre, et qui permet l'émergence des produits volcaniques.
C'est par les cheminées ou conduits
que la roche en fusion arrive jusqu'à la surface. Ce que nous pouvons
appercevoir est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé dans un réservoir
par la fusion de roches, s'est continué par la monté de ces magmas
chargés en gaz, avant de se terminer par l'arrivée de ces matières à la
surface. Ce que nous appelons "volcans"
n'est que l'appareil naturel, qui fait communiquer les zones profondes et la
surface de la Terre, et qui permet l'émergence des produits volcaniques.
![]() Un géologue américain a donné une définition
assez juste du volcanisme, en disant que "C'est l'ensemble des phénomènes
physico-chimiques qui accompagnent l'ascension des magmas".
Les éruptions seraient dues
à la décompression soudaine des gaz dissous dans le magma.
Un géologue américain a donné une définition
assez juste du volcanisme, en disant que "C'est l'ensemble des phénomènes
physico-chimiques qui accompagnent l'ascension des magmas".
Les éruptions seraient dues
à la décompression soudaine des gaz dissous dans le magma.
![]() La
tectonique des plaques explique la répartition des volcans.
En effet, ils se localisent en majorité là où la croûte terrestres se casse,
coulisse, se compresse ou se plisse, là où les secousses telluriques abondent
: aux limites entre les plaques, le long des dorsales
et des arcs.
La
tectonique des plaques explique la répartition des volcans.
En effet, ils se localisent en majorité là où la croûte terrestres se casse,
coulisse, se compresse ou se plisse, là où les secousses telluriques abondent
: aux limites entre les plaques, le long des dorsales
et des arcs.
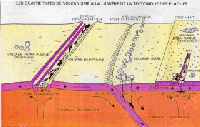
![]() L'écorce terrestre est divisée en
huit grandes plaques lithosphèriques
: l'eurasienne, l'africaine, la nord-américaine, la sud-américaine, la nazca,
la pacifique, l'indo-australienne et l'antarctique. Elles dérivent les unes par
rapport aux autres, s'écartent ou se rapprochent, s'emboutissent ou se
chevauchent durant les millions d'années d'existence de notre planète. La
majorité des tremblements de terre et des éruptions
volcaniques sont situés près des intersections de deux plaques. Les volcans
sont donc installés là où il y a d'une part divergence de deux plaques et
formation de rifts, c'est-à-dire de fossés d'effondrement, et d'autre part
convergence de deux plaques. Le volcanisme le plus répendu est celui situé près
des écartements de deux plaques.
L'écorce terrestre est divisée en
huit grandes plaques lithosphèriques
: l'eurasienne, l'africaine, la nord-américaine, la sud-américaine, la nazca,
la pacifique, l'indo-australienne et l'antarctique. Elles dérivent les unes par
rapport aux autres, s'écartent ou se rapprochent, s'emboutissent ou se
chevauchent durant les millions d'années d'existence de notre planète. La
majorité des tremblements de terre et des éruptions
volcaniques sont situés près des intersections de deux plaques. Les volcans
sont donc installés là où il y a d'une part divergence de deux plaques et
formation de rifts, c'est-à-dire de fossés d'effondrement, et d'autre part
convergence de deux plaques. Le volcanisme le plus répendu est celui situé près
des écartements de deux plaques.
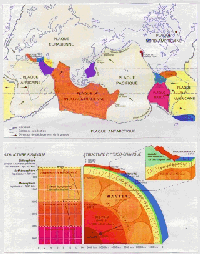
![]() Les matériaux volcaniques proviennent
en partie de l'asthénosphère, zone visqueuse du manteau immédiatement située
sous la lithosphère qui
comprend la partie supérieure du manteau et la croûte terrestre. Et donc, ces
roches volcaniques arrivent à la surface à la faveur de fractures qui sont liées
aux contacts entre plaques lithosphèriques.
Les matériaux volcaniques proviennent
en partie de l'asthénosphère, zone visqueuse du manteau immédiatement située
sous la lithosphère qui
comprend la partie supérieure du manteau et la croûte terrestre. Et donc, ces
roches volcaniques arrivent à la surface à la faveur de fractures qui sont liées
aux contacts entre plaques lithosphèriques.
![]() Mais ceci explique une
partie de l'origine des volcans,
et laisse en suspend l'origine de ceux qui se trouvent au milieu des plaques,
soit sur les continents soit dans les profondeurs des océans. Ces volcans
seraient, selon un américain, le moyen que possède la Terre pour se débarrasser
de son trop plein de chaleur interne, tout comme les cyclones évacuent vers les
pôles trop froids la chaleur de l'équateur pour rétablir l'équilibre
thermique de l'atmosphère.
Mais ceci explique une
partie de l'origine des volcans,
et laisse en suspend l'origine de ceux qui se trouvent au milieu des plaques,
soit sur les continents soit dans les profondeurs des océans. Ces volcans
seraient, selon un américain, le moyen que possède la Terre pour se débarrasser
de son trop plein de chaleur interne, tout comme les cyclones évacuent vers les
pôles trop froids la chaleur de l'équateur pour rétablir l'équilibre
thermique de l'atmosphère.
![]() La désintégration des éléments
radioactifs contenus dans les couches profondes de la Terre libère de
fabuleuses quantités d'énergie. La conductivité des roches permet d'en
dissiper une partie, en nous apportant un chauffage naturel du sous-sol. En
effet, pour mieux comprendre le phénomène, il suffit de descendre dans une
mine : chaque fois que l'on s'enfonce de 100 mètres sous la terre, la température
augmente de 3 °C.
La désintégration des éléments
radioactifs contenus dans les couches profondes de la Terre libère de
fabuleuses quantités d'énergie. La conductivité des roches permet d'en
dissiper une partie, en nous apportant un chauffage naturel du sous-sol. En
effet, pour mieux comprendre le phénomène, il suffit de descendre dans une
mine : chaque fois que l'on s'enfonce de 100 mètres sous la terre, la température
augmente de 3 °C.
![]() Mais cette conductivité naturelle
n'est pas suffisante pour évacuer toute la chaleur. Alors, de temps en temps,
la matière s'élève vers la surface emportant avec elle la chaleur en excédent.
Au passage, elle échauffe les couches supérieures qu'elle traverse, déclenchant
de vastes mouvements de convection. Et donc, parfois, en remontant, elle
rencontre un continent et l'on obtient un déchaînement volcanique.
Mais cette conductivité naturelle
n'est pas suffisante pour évacuer toute la chaleur. Alors, de temps en temps,
la matière s'élève vers la surface emportant avec elle la chaleur en excédent.
Au passage, elle échauffe les couches supérieures qu'elle traverse, déclenchant
de vastes mouvements de convection. Et donc, parfois, en remontant, elle
rencontre un continent et l'on obtient un déchaînement volcanique.
![]() Mais tous les volcans
ne sont pas constitués par l'effusion de matériaux provenant de l'athénosphère.
En général, la roche en fusion progresse dans des fractures et, comme elle est
très chaude, elle fait fondre la roche en donnant naissance à une cavité
souterraine appelée chambre magmatique. Cette chambre est donc constituée de
roches provenant du manteau, qui ont incorporé une quantité plus ou moins
grande de roches de la croûte.
Mais tous les volcans
ne sont pas constitués par l'effusion de matériaux provenant de l'athénosphère.
En général, la roche en fusion progresse dans des fractures et, comme elle est
très chaude, elle fait fondre la roche en donnant naissance à une cavité
souterraine appelée chambre magmatique. Cette chambre est donc constituée de
roches provenant du manteau, qui ont incorporé une quantité plus ou moins
grande de roches de la croûte.
![]() Comme nous l'avons vu dans les
chapitres précédents, une éruption
volcanique est l'ascension d'un
magma issu de la profondeur de la Terre et porté à des températures élevées,
supérieures à 1000 °C. Mais l'aspect des appareils volcaniques et de leurs
produits dépendent de la qualité du magma
émis au moment de l'éruption,
et en particulier de la teneur en gaz des laves.
Comme nous l'avons vu dans les
chapitres précédents, une éruption
volcanique est l'ascension d'un
magma issu de la profondeur de la Terre et porté à des températures élevées,
supérieures à 1000 °C. Mais l'aspect des appareils volcaniques et de leurs
produits dépendent de la qualité du magma
émis au moment de l'éruption,
et en particulier de la teneur en gaz des laves.
![]() Généralement, un volcan
qui n'émet que des gaz est en phase d'activité faible. Par contre, on ne sait
pratiquement rien sur l'origine de ceux-ci, qui sont souvent nauséabonds et
violemment éjectées, en quantités colossales pendant les éruptions.
En effet, leur volume et parfois leurs poids sont presque toujours des dizaines
voire des centaines de fois supérieurs à ceux des cendres et de la lave
vomies par l'appareil volcanique.
Généralement, un volcan
qui n'émet que des gaz est en phase d'activité faible. Par contre, on ne sait
pratiquement rien sur l'origine de ceux-ci, qui sont souvent nauséabonds et
violemment éjectées, en quantités colossales pendant les éruptions.
En effet, leur volume et parfois leurs poids sont presque toujours des dizaines
voire des centaines de fois supérieurs à ceux des cendres et de la lave
vomies par l'appareil volcanique.
![]() Sans oublier les dernières éruptions
de la Soufrière, vous pouvez constater que les panaches qui jaillissent des
cratères actifs montent souvent très haut et atteignent parfois des dizaines
de kilomètres de hauteur. Leur température peut atteidre 1200 °C et leur
vitesse d'ascension, 200 kilomètres à l'heure. Pour l'essentiel, ces gaz sont
constitués d'eau qui incorpore des chlorures, des carbonates, et des sulfates.
Mais on trouve aussi du gaz carbonique et de l'oxyde de carbone, du méthane, de
l'ammoniaque et de l'acide chlorhydrique, a plus faible quantité.
Sans oublier les dernières éruptions
de la Soufrière, vous pouvez constater que les panaches qui jaillissent des
cratères actifs montent souvent très haut et atteignent parfois des dizaines
de kilomètres de hauteur. Leur température peut atteidre 1200 °C et leur
vitesse d'ascension, 200 kilomètres à l'heure. Pour l'essentiel, ces gaz sont
constitués d'eau qui incorpore des chlorures, des carbonates, et des sulfates.
Mais on trouve aussi du gaz carbonique et de l'oxyde de carbone, du méthane, de
l'ammoniaque et de l'acide chlorhydrique, a plus faible quantité.
![]() Outre les gaz, le volcan
rejette également de la lave.
Ce terme est d'origine napolitaine : ils reprirent le terme "lava" qui
désignait un torrent provoqué par des chutes de pluies abondantes, pour
parler, dans leur dialècte, des coulées de roches en fusion dévalant les
pentes du Vésuve. La lave est
un magma qui a perdu l'essentiel de ses gaz en arrivant à la surface.
Outre les gaz, le volcan
rejette également de la lave.
Ce terme est d'origine napolitaine : ils reprirent le terme "lava" qui
désignait un torrent provoqué par des chutes de pluies abondantes, pour
parler, dans leur dialècte, des coulées de roches en fusion dévalant les
pentes du Vésuve. La lave est
un magma qui a perdu l'essentiel de ses gaz en arrivant à la surface.
![]() La température de la
lave varie de 400 à 1200 °C. Les différences de température sont dues à
la composition de la lave, et
cela influe aussi sur la vitesse d'écoulement de celle-ci. En effet, une lave
basique, pauvre en silice mais riches en ferro-magnésiens, sont plus chaudes,
mais aussi plus fluides que les
laves acides, riches en silice et visqueuses. Les écoulements des
laves vont de quelques mètres à l'heure jusqu'à 40 kilomètres à
l'heure.
La température de la
lave varie de 400 à 1200 °C. Les différences de température sont dues à
la composition de la lave, et
cela influe aussi sur la vitesse d'écoulement de celle-ci. En effet, une lave
basique, pauvre en silice mais riches en ferro-magnésiens, sont plus chaudes,
mais aussi plus fluides que les
laves acides, riches en silice et visqueuses. Les écoulements des
laves vont de quelques mètres à l'heure jusqu'à 40 kilomètres à
l'heure.
![]() Les coulées prennent deux types
d'aspect. Les basiques sont presque lisses. Ce sont les laves
que l'on appelle laves cordées ou en écaille des pahoehoe,
terme d'origine hawaiienne. Elle ressemble à du goudron qui a refroidi en
bourrelets successifs. Sous l'eau, elles se disposent en coussins, les
pillow-lavas ou laves en polochons. Une croûte durcit rapidement sous l'effet
du refroidissement par l'eau, alors que l'intérieur reste pâteux. Cette croûte
s'amincit au fur et à mesure, et va permettre, sous l'effet de la poussée de
libérer, en se brisant, des boudins ou polochons de lave qui roulent au pied du
front de coulée. Ainsi se forme, en s'empilant, les pillow-lavas qui peuvent
atteindre parfois de 50 cm à 1 mètre de diamètre.
Les coulées prennent deux types
d'aspect. Les basiques sont presque lisses. Ce sont les laves
que l'on appelle laves cordées ou en écaille des pahoehoe,
terme d'origine hawaiienne. Elle ressemble à du goudron qui a refroidi en
bourrelets successifs. Sous l'eau, elles se disposent en coussins, les
pillow-lavas ou laves en polochons. Une croûte durcit rapidement sous l'effet
du refroidissement par l'eau, alors que l'intérieur reste pâteux. Cette croûte
s'amincit au fur et à mesure, et va permettre, sous l'effet de la poussée de
libérer, en se brisant, des boudins ou polochons de lave qui roulent au pied du
front de coulée. Ainsi se forme, en s'empilant, les pillow-lavas qui peuvent
atteindre parfois de 50 cm à 1 mètre de diamètre.
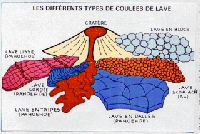
![]() Les laves
acides donnent des coulées avec des surfaces irrégulière, parsemées de blocs
et de scories, fragments de
lave. Cet aspect est celui que l'on rencontre dans les nombreuses coulées
volcaniques d'Auvergne appelées cheires,
ou Aa, terme d'origine
hawaiienne.
Les laves
acides donnent des coulées avec des surfaces irrégulière, parsemées de blocs
et de scories, fragments de
lave. Cet aspect est celui que l'on rencontre dans les nombreuses coulées
volcaniques d'Auvergne appelées cheires,
ou Aa, terme d'origine
hawaiienne.
![]() Mais, les volcans
emettent également des projections, qui se solidifient dans l'air et que l'on
appelle pyroclastites, ce qui signifie 'débris de feu'. Les débris sont classés
par taille. C'est ainsi que les plus fins sont appelés cendres, en fait ce sont
de minuscules fragments de lave
pulvérisée par les explosions. Ensuite, les débris de quelques millimètres
de diamètres sont appelés des lapilli
(petites pierres en italien), et les scories,
qui correspondent à des fragments de lave non cristallisée, ont quelques
centimètres. Vous pouvez même avoir des retombés de gros blocs de forme ovale
à l'état visqueux, que l'on appelle des bombes.
Mais, les volcans
emettent également des projections, qui se solidifient dans l'air et que l'on
appelle pyroclastites, ce qui signifie 'débris de feu'. Les débris sont classés
par taille. C'est ainsi que les plus fins sont appelés cendres, en fait ce sont
de minuscules fragments de lave
pulvérisée par les explosions. Ensuite, les débris de quelques millimètres
de diamètres sont appelés des lapilli
(petites pierres en italien), et les scories,
qui correspondent à des fragments de lave non cristallisée, ont quelques
centimètres. Vous pouvez même avoir des retombés de gros blocs de forme ovale
à l'état visqueux, que l'on appelle des bombes.
![]() C'est en se basant sur l'étude des
produits émis par le volcan
que l'on détermine les différents types d'éruption.
C'est en se basant sur l'étude des
produits émis par le volcan
que l'on détermine les différents types d'éruption.