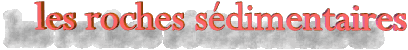
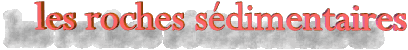
Si les roches ignées forment le gros du volume de la croûte terrestre, les roches sédimentaires forment le gros de la surface de la croûte. Quatre processus conduisent à la formation des roches sédimentaires : l'altération superficielle des matériaux qui produit des particules, le transport de ces particules par les cours d'eau, le vent ou la glace qui amène ces particules dans le milieu de dépôt, la sédimentation qui fait que ces particules se déposent dans un milieu donné pour former un sédiment et, finalement, la diagenèse qui transforme le sédiment en roche sédimentaire.
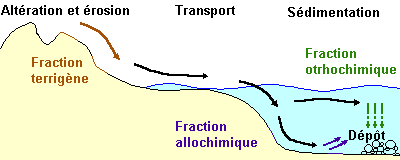 |
D'autre part, le matériel sédimentaire peut provenir de trois sources : une source terrigène, lorsque les particules proviennent de l'érosion du continent, une source allochimique, lorsque les particules proviennent du bassin de sédimentation, principalement des coquilles ou fragments de coquilles des organismes et une source orthochimique qui correspond aux précipités chimiques dans le bassin de sédimentation ou à l'intérieur du sédiment durant la diagenèse. |
L'altération
superficielle :
Elle se produit de trois manières : mécanique, chimique et biologique. Les
processus mécaniques (ou physiques) sont ceux qui désagrègent mécaniquement
la roche, comme l'action du gel et du dégel qui agrandit progressivement les
fractures. L'action mécanique des racines des arbres ouvre aussi les fractures.
L'altération chimique est très importante : plusieurs silicates, comme les
feldspaths, souvent abondants dans les roches ignées, sont facilement attaqués
par les eaux de pluies et transformés en minéraux des argiles (phyllosilicates)
pour former des boues. Certains organismes ont également la possibilité
d'attaquer biochimiquement les minéraux et certains lichens vont chercher dans
les minéraux les éléments chimiques dont ils ont besoin. L'action combinée
de ces trois mécanismes produit des particules de toutes tailles. C'est là le
point de départ du processus général de la sédimentation.
| Le transport : Outre le vent et la glace, c'est surtout l'eau qui assure le transport des particules. Selon le mode et l'énergie du transport, le sédiment résultant comportera des structures sédimentaires variées : stratification en lamelles planaires, obliques ou entrecroisées... etc. dont les roches sédimentaires hériteront. Le transport des particules peut être très long, en fait au final toutes les particules devront se retrouver dans un grand bassin ou dans le bassin océanique. |
 |
La sédimentation :
Tout le matériel transporté s'accumule dans un bassin de sédimentation pour
former un dépôt. Les sédiments se déposent en couches successives dont la
composition, la taille des particules, la couleur, etc., varient dans le temps
selon la nature des sédiments apportés. C'est ce qui fait que les dépôts sédimentaires
sont stratifiés et que les roches sédimentaires issues de ces dépôts
composent les paysages stratifiés comme ceux du Grand Canyon du Colorado par
exemple.
La diagenèse :
La diagenèse englobe tous les processus chimiques et mécaniques qui affectent
un dépôt sédimentaire après sa formation. Elle commence sur le fond du
bassin et se poursuit tout au long de son enfouissement, à mesure que d'autres
sédiments viennent recouvrir le dépôt et l'amener progressivement sous
plusieurs dizaines, centaines ou même milliers de mètres de matériel. Les
processus de diagenèse sont variés et complexes : ils vont du compactage du sédiment
à sa cimentation, en passant par des phases de dissolution, de
recristallisation ou de remplacement de certains minéraux. Le processus diagénétique
qui est principalement responsable du passage de sédiment à roche est la
cimentation. Il s'agit d'un processus relativement simple : si l'eau qui circule
dans un sédiment, par exemple un sable, est sursaturée par rapport à certains
minéraux, elle précipite ces minéraux dans les pores du sable et ceux-ci
viennent souder ensemble les particules du sable, on obtient alors une roche sédimentaire
qu'on appelle un grès. Le degré de cimentation peut être faible, pour les
roches friables, ou il peut être très poussé dans des roches très solides.
| Les minéraux de la séquence évaporitique
: Plusieurs cristaux, et parmi les plus beaux spécimens, se forment à partir de solutions sursaturées en certains éléments chimiques, c'est-à-dire une solution qui contient plus de sels qu'elle ne peut en dissoudre. Les cristaux précipitent à partir de la solution selon divers processus, notamment l'évaporation. Un bon exemple est la suite de minéraux qui précipitent quand s'évapore de l'eau de mer. Les schémas qui suivent illustrent de façon très simplifiée comment se forme cette suite. |
|
| L'eau de mer contient une panoplie importante d'ions en solution et l'évaporation
ne se débarrasse que de l'eau, ce qui fait qu'au fur et à mesure que
l'eau se vaporise, la solution devient de plus en plus saline et les
sels se concentrent. L'eau de mer normale a une salinité de l'ordre de 35 ppm. A cette salinité, elle est légèrement sursaturée par rapport au carbonate de calcium, CaCO3. Ce dernier précipite naturellement et dépose une couche de cristaux de CaCO3 au fond du bocal. |
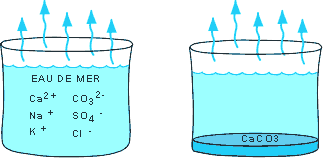 |
|
|
Avec la poursuite de l'évaporation et par conséquent l'augmentation de la salinité, la solution devient sursaturée par rapport à un autre sel, le gypse hydraté (CaSO4) donc il précipite. Puis, avec encore une augmentation de la salinité, vient la phase de précipitation du chlorure de sodium, NaCl (halite, le sel commun). |
| La dernière phase avant l'évaporation totale est le chlorure de
potassium, KCl (sylvite, communément appelée potasse). On obtient donc
une suite bien spécifique de minéraux précipités à mesure de l'évaporation
de l'eau de mer. Au moins trois de ces minéraux interviennent dans les
activités humaines : le gypse, le sel de table et de routes, et la
potasse pour les fertilisants. |
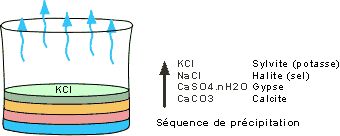 |
Comment cela se
traduit-il dans la nature?
La précipitation des minéraux évaporitiques se fait, entre autres, dans les
grandes lagunes en bord de mer, lagunes qui se mesurent en plusieurs dizaines ou
centaines de kilomètres carrés, dans des régions où l'évaporation excède
la précipitation. Le gros de l'alimentation en eau de ces lagunes vient de la
mer. L'évaporation concentre la solution et les minéraux évaporitiques
s'accumulent au plancher de la lagune. Pour une région donnée, il s'établira
une sorte d'équilibre entre l'alimentation de la lagune en eau marine et l'évaporation,
ce qui fait que la salinité de l'eau demeurera à peu près constante. En
fonction de cette salinité, c'est l'un ou l'autre des minéraux de la séquence
qui précipite. Le plus souvent, on oscille entre la calcite et le gypse, on se
rend plus rarement au sel et encore moins souvent à la potasse. C'est ainsi que
se sont formés, tout au long des temps géologiques, les grands dépôts de
sels ou de potasse fossile.
Dans une variante du système évaporitique, les minéraux cristallisent et croissent à l'intérieur du sédiment. Il s'agit de grandes plaines en bordure de mer qui s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés, mais dont la surface est à peine quelques mètres au-dessus du niveau marin. C'est ce qu'on appelle la sebkha. Les magnifiques roses des sables se développent à l'intérieur de ces sables dans les zones désertique.
La dénomination des sédiments et roches sédimentaires se fait en deux temps.
|
D'abord selon la taille des particules (la granulométrie) chez les terrigènes et les allochimiques. Deux tailles sont importantes à retenir : 0,062 et 2 mm. La granulométrie n'intervient pas dans le cas des orthochimiques puisqu'il s'agit de précipités chimiques et non de particules transportées. Ensuite, on complète la classification par la composition minéralogique. La composition des particules des terrigènes se résume au quartz, feldspath, fragments de roches et minéraux des argiles. Quant aux allochimiques, ce sont principalement des calcaires, ce qui est réflété par le préfixe CAL dans le nom. Les particules des allochimiques sont formées en grande partie par les coquilles ou morceaux de coquilles des organismes vivants. Les sédiments des zones tropicales sont surtout formés de ces coquilles. Chez les orthochimiques, le nom est essentiellement déterminé selon la composition chimique. Pour obtenir plus d'informations sur le nom des roches, consultez aussi le dossier de notre-planete.info : le nom des roches. |
|
Les roches métamorphiques :
Les roches métamorphiques sont issues de la transformation de roches ignées ou sédimentaires sous l'effet de température et/ou de pressions élevées. Il existe trois types de métamorphisme : le métamorphisme de contact, le métamorphisme régional et le métamorphisme de choc.
|
Le métamorphisme de contact : Les minéraux de cette roche sont transformés par la chaleur et on obtient une roche métamorphique. On appelle cette bordure transformée une auréole métamorphique. Sa largeur sera fonction de la dimension de la masse intrusive, de quelques millimètres à plusieurs centaines de mètres, allant même à quelques kilomètres. |
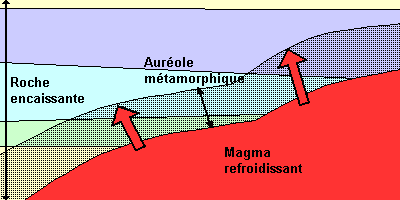 |
Le métamorphisme régional
:
Le métamorphisme régional est celui qui affecte de grandes régions. Il n'est
pas produit par les éruptions de magma mais par les efforts et les compressions
qui sont due aux mouvement tectoniques. Les roches qui se trouvent à la base
des chaînes de montagnes ont été transformées par les contraintes.
Le métamorphisme de
choc :
Le métamorphisme de choc est produit par la chute d'une météorite à la
surface de la planète. Le choc engendre des températures et des pressions énormément
élevées qui sont bien au-delà de celles atteintes dans le métamorphisme régional
et qui transforment les minéraux de la roche choquée.
Le nom des roches métamorphiques :
Le gros des roches métamorphiques (en volume) provient du métamorphisme régional. Selon le degré de métamorphisme régional, il se développe une suite bien spécifique de minéraux.
| Ces minéraux deviennent donc, pour une roche métamorphique donnée, des indicateurs du degré de métamorphisme qu'à subit la roche. A partir des assemblages minéralogiques, on peut établir le niveau des pressions et des températures à laquelles a été soumise la roche, et ainsi évaluer sa profondeur d'enfouissement dans les racines d'une chaîne de montagne. Comme pour les roches ignées et sédimentaires, on applique un certain nombre de noms aux roches métamorphiques. Le tableau de droite présente les plus courants. |
| |||||