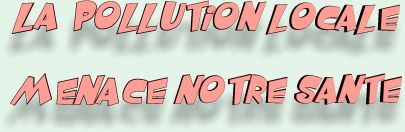
> Le dioxyde de soufre ou l'anhydride sulfureux (SO2)

Son origine est liée à la présence de soufre, impureté qui est contenue dans presque tous les combustibles fossiles, notamment le fuel et le charbon ; leur combustion oxydant le soufre en oxyde de soufre.
Les principales sources de ce gaz sont les centrales thermiques, les
centres de production de chauffage, et les grosses installations de
combustion de l'industrie. Les secteurs tertiaire et résidentiel
(chauffage individuel ou collectif) constituent le deuxième type d'émetteur,
alors que les transports ne représentent qu'une faible part des émissions
totales, pour la plupart à cause du trafic
diesel. Ainsi, les émissions de dioxyde de soufre sont surtout
concentrées en période de chauffe hivernale.
C'est un irritant respiratoire qui agit en synergie avec les particules et
se retrouve davantage dans les zones industrielles. C'est le polluant dont
l'impact sur l'ensemble des êtres vivants est de loin le plus préoccupant.
En effet, il provoque à court terme un accroissement de la morbidité
respiratoire voire à plus long terme, des risques de bronchite chronique.
Il se transforme rapidement dans l'air en acide sulfurique, très
hygroscopique, qui conditionne la formation des smogs acides. L'anhydride
sulfureux est aussi responsable des pluies acides, en provocant une
acidification incessante du pH des précipitations dans l'ensemble des
pays industrialisés. Ce qui engendre notamment un dépérissement à
vaste échelle des forêts de conifères, et de l'acidification des eaux
des lacs situés sur terrains cristallins.
Les teneurs moyennes annuelles en dioxyde de soufre ont été divisés par
10 en quarante ans environ. En effet, de grand progrès ont été réalisés
notamment dans les années soixante-dix sur les émissions industrielles
et/ou liées aux rejets de chauffage. Ainsi, la diminution sensible de
l'industrialisation de la région, l'utilisation de l'énergie nucléaire
pour la production d'électricité au détriment des centrales thermiques,
et la prise de mesures techniques et réglementaires, ont eu pour effet de
faire nettement diminuer les émissions de dioxyde de soufre. De plus, la
diminution sensible du taux de soufre dans le gasoil dès le 1er octobre
1996 (0,05 % au lieu de 0,2 %) a contribué à diminuer encore la part du
secteur transport dans les rejets de dioxyde de soufre.
Les particules en suspension
On peut ainsi y relever du carbone, des composés minéraux d'origine
tellurique ou anthropique (métaux, sels, nitrates, sulfates, composés
organiques : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)). Les sulfates
et le carbone restent les constituants principaux des particules. De plus,
celles qui sont émises par les différentes sources se modifient au cours
de leur passage dans l'atmosphère. Par exemple, une particule carbonée
d'origine diesel de 0,1 micromètre (µm) peut s'agglomérer avec d'autres
particules et s'enrober de nitrates et de sulfates provenant de la
transformation chimique des polluants gazeux.
Elles sont mesurées suivant différentes méthodes : la méthode des Fumées
Noires (FN) qui prend en compte les particules carbonées de moins de 5 µm,
et les PM qui signifient "Particulate Mater" en anglais, le
nombre suivant désignant la taille supérieure en micromètre des
particules mesurées (ex. les PM13 rassemblent toutes les particules de
moins de 13 µm).
Enfin, l'évolution quantitative des poussières, montre que depuis 1956,
les teneurs annuelles de fumées noires ont diminué de près de 80% pour
les sites de pollution urbaine de fond. On observe cependant une certaine
stabilité depuis une dizaine d'années avec même une légère
augmentation pour l'année 1998. De surcroît, des méthodes de calcul
différentes instaurées à partir de 1993 induisent des indices de fumées
noires plus faibles de 25% environ par rapport aux années précédentes.
> Les oxydes d'azote (NOx)
Près d'un tiers des émissions de dioxyde d'azote est d'origine
anthropique. Les transports routiers sont les principaux responsables de
ces rejets avec environ deux tiers en Île-de-France (CITEPA,1998).
C'est pour cela que ce polluant reste un bon indicateur du trafic automobile. Le reste provient des sources fixes de combustion telles que les centrales thermiques de production électrique, les installations de chauffage ou encore les usines d'incinération.
Les NOx sont à l'origine des dépôts acides avec le SO2 et participent à la pollution photochimique. En effet, ils se transforment en des composés très dangereux, les peroxyacylnitrates (PAN) dans les atmosphères urbaines polluées et ensoleillées. Ces dernières sont le siège de diverses réactions conduisant à la formation d'O3, lequel va à son tour agir sur d'autres polluants, par exemple les hydrocarbures imbrûlés, qu'il oxyde en peroxyacycles.
La réaction de ces derniers avec les oxydes d'azote
produit des PAN, lesquels sont particulièrement toxiques à la fois pour
les végétaux et les animaux. De plus, à des concentrations élevées,
les oxydes d'azote peuvent engendrer des maladies respiratoires
chroniques.
Dans l'agglomération parisienne, les émissions d'oxyde d'azote se
stabilisent depuis les années quatre-vingts. Les concentrations varient
selon les saisons. Les niveaux de NO2 semblent se stabiliser entre 50 et
60 µg.m-3 en hiver et 40 à 50µg.m-3 en été. Alors qu'on observe
une décroissance relative en comparaison interanuelle pour les oxydes
d'azote. Cette légère baisse est due à l'introduction des pots
catalytiques sur les véhicules. Pourtant, l'intensité du trafic compense
en partie cette évolution.
> Le monoxyde de carbone (CO)
A forte dose, il agit sur l'hémoglobine qui ne fixe plus l'oxygène et peut engendrer des lésions du système nerveux et des troubles cardio-vasculaires. En effet, une asphyxie générale de l'organisme, et plus particulièrement du cerveau peut survenir, ce qui conduirait à une grande fatigue, des céphalées, des dépressions et des complications neuropsychiques (F. VERLEY, 1994).
> Les composés organiques volatils

Les COV regroupent de nombreuses espèces parmi lesquelles :
- des composés aromatiques monocycliques (HAM), qui représentent
jusqu'à 30 % des hydrocarbures non méthaniques dans la plupart des
milieux urbains et concourent avec les oxydes d'azote à la formation
des photo-oxydants dans l'air ambiant. Ils comprennent notamment le
benzène, le toluène, l'éthylbenzène, les xylènes et le 1,2,4 triméthylbenzène
(124 TMB)
- des hydrocarbures volatils (alcanes, alcènes, aromatiques)
- des composés carbonylés (aldéhydes et cétones)
Ces substances ont des propriétés chimiques et toxicologiques qui varient d'un composé ou d'une famille à l'autre. Les effets sur la santé vont de la simple gêne olfactive, à l'irritation (aldéhydes), à une diminution de la capacité respiratoire jusqu'aux effets mutagènes et cancérogènes (comme le benzène et benzo(a)pyrène)
Parmi ces polluants celui qui est le plus connu et le plus suivi est le benzène. L'évolution des concentrations en benzène montre une baisse depuis 1994 sur trois sites de mesure d'AIRPARIF, (le réseau de surveillance de la pollution en Île-de-France) la place Victor Basch et la rue de Dantzig étant des stations de trafic respectivement de circulation intense et moyenne. L'objectif de qualité de 2 µg.m-3 en moyenne annuelle est nettement dépassé. Ce polluant demeure donc très préoccupant.
> Les métaux lourds
Le plomb provient principalement de la combustion des additifs au plomb contenu dans l'essence."Incorporé de façon systématique à l'essence en raison de ses propriétés antidétonantes, il constitue à lui seul 80% des 1 000 tonnes qui sont rejetées, chaque année, dans l'atmosphère. Heureusement, sa teneur dans les carburants a été progressivement réduite, jusqu'à son interdiction définitive le 1er janvier 2000. Résultat : en dehors de quelques agglomérations industrielles comme Dunkerque, plus aucune ville ne connaît de taux important de plomb dans l'air. « Et cela va continuer à baisser, au rythme du renouvellement du parc automobile», assure Philippe Vesseron, directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'Environnement (02/03/2000).
Avec la baisse puis la suppression de la quantité de plomb dans l'essence, ce polluant perd aujourd'hui sa pertinence en tant qu'indicateur de la pollution automobile. Or, le plomb particulaire, supporté par les particules fines en suspension dans l'air, est fixé par l'organisme. C'est un toxique neurologique, hématologique et rénal. Il faut noter que les voies d'imprégnation de ce dernier sont multiples et la part atmosphérique reste très réduite.
Même sur des sites à fort trafic les concentrations en plomb décroissent nettement. Depuis 1994, les teneurs tendent à se stabiliser à un niveau relativement bas (entre 0,15 et 0,3 µg.m-3) en raison d'un usage maintenant bien établi des carburants non plombés (Super98, Super95 et gazole) sur la région.
Pour les autres métaux lourds, le nickel, le cadmium et l'arsenic, leur dangerosité est liée, entre autres, à des propriétés cancérigènes.