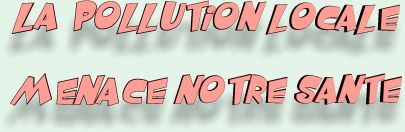La dernière évaluation du programme APHEIS dans 26 villes indique que
la pollution atmosphérique menace toujours la santé publique en Europe
Le programme Apheis (Air Pollution and Health: A European Information
System) a communiqué le 06/09/04 les derniers résultats de l’évaluation
d’impact sanitaire (EIS) de la pollution atmosphérique effectuée
dans 26 villes de 12 états européens dont la France. Les résultats de
la troisième phase de ce programme confirment la conclusion
d’Apheis-2 : la pollution atmosphérique continue de poser un problème
de santé publique en milieu urbain en Europe.
Cette nouvelle phase Apheis-3 s’est également attachée à
investiguer le sujet essentiel de comment communiquer de façon efficace
avec ceux qui influencent et décident des politiques de santé publique
et de pollution atmosphérique en Europe.
Créé en 1999, le
programme Apheis est co-financé par la Direction Générale Santé
et Protection des Consommateurs de la Commission Européenne et par les
institutions participantes au programme dans chaque ville. La
coordination est assurée par l’Institut de veille sanitaire (InVS,
France) et par l’Agencia de Salut Pùblica de Barcelona (ASPB,
Espagne).
De nouvelles sources de données et de nouveaux calculs confirment
une menace continue pour la santé publique.
Afin d’élargir et d’approfondir les conclusions de la phase 2 du
programme, le dernier volet d’évaluation d’impact sanitaire a intégré
de nouvelles sources de données à ses analyses. Notamment Apheis-3 a
inclus des données sur les PM2.5 (particules d’un diamètre inférieur
à 2,5 micromètres) qui sont venues s’ajouter aux mesures de
l’indice des fumées noires et des PM10 (particules d’un diamètre
inférieur à 10 micromètres). Apheis a également étudié les causes
spécifiques de mortalité (cardio-pulmonaire et par cancer du poumon)
et les données de mortalité totale. Et, en plus d’estimer les décès
imputables à la pollution atmosphérique à un moment donné, Apheis-3
s’est attaché également à calculer les gains en espérance de vie
dans le but de fournir une image dynamique des effets de la pollution
sur la santé au cours de la vie.
Les résultats d’Apheis-3 indiquent qu’une réduction des niveaux de
PM 2.5 à 15 µg/m3 induit un bénéfice en termes de mortalité (totale
et spécifique) de 30 % supérieur à une réduction des niveaux de PM
2.5 à 20 µg/m3.
Plus précisément, Apheis-3 a estimé à 11 375 le nombre décès prématurés
(dont 8 053 d’origine cardio-pulmonaire et 1 296 par cancer du poumon)
qui pourraient être prévenus chaque année si, toutes choses étant égales
par ailleurs, l’exposition à long terme aux PM 2.5 était ramenée à
20 µg/m3 dans chaque ville. La réduction à 15 µg/m3 de ces mêmes
particules entraînerait la prévention de quelque 16 926 décès prématurés
(dont 11 612 d’origine cardio-pulmonaire et 1 901 par cancer du
poumon).
En termes d’espérance de vie, toutes choses étant égales par
ailleurs, une moyenne annuelle de PM2.5 qui n’excéderait pas 15 µg/m3
se traduirait par un gain moyen de 2 à 13 mois d’espérance de vie
pour une personne de 30 ans.
Ces conclusions sur les bénéfices d’une réduction des PM2.5 à 20
et à 15 µg/m3 sont particulièrement déterminantes à l’heure où
dans la cadre du programme CAFE de la Commission européenne se déroulent
les discussions visant à déterminer les valeurs limites de PM2.5
En particulier, pour des raisons de santé publique, Apheis recommande
que la valeur limite de PM2.5 soit fixée à 15 µg/m3. Toutefois, les bénéfices
sanitaires que l’on peut espérer d’un tel abaissement seraient
encore plus flagrants si la valeur limite était fixée en dessous de ce
seuil.
Concernant les bénéfices escomptés d’une réduction de
l’exposition aux PM10 à très court, court et long termes, dans les
23 villes du programme Apheis qui les mesurent et totalisent près de 36
millions d’habitants, toutes choses étant égales par ailleurs, l’EIS
indique que si l’exposition aux PM10 était réduite à 20 µg/m3 :
- 2 580 décès prématurés (dont 1 741 d’origine cardio-vasculaire
et 429 d’origine respiratoire) pourraient être prévenus chaque année
si l’impact est seulement estimé sur une très courte période de
deux jours ;
- l’impact à court terme, cumulé sur 40 jours, serait de plus de 2
fois supérieur, totalisant
5 240 décès qui pourraient être prévenus chaque année (dont 3 458
d’origine cardio-vasculaire et 1 348 d’origine respiratoire) ;
- sur le long terme (plusieurs années) l’impact est plus important et
peut être estimé à 21 828 décès prématurés prévenus
annuellement.
Pour ce qui est de la capacité des villes Apheis à respecter les
futures valeurs limites de la Commission européenne pour PM10 en 2005
et 2010, Apheis-3 a montré que si la plupart des villes respectent déjà
la valeur limite 2005 de 40 µg/m3, 21 villes continuent de dépasser la
valeur limite de 20 µg/m3 prévue pour 2010.
Pour l’indice des fumées noires (généralement considéré comme un
bon indicateur de la pollution liée au trafic automobile), dans les 16
villes du programme qui le mesure (24 millions d’habitants), on estime
que sa réduction à une valeur journalière de 20 µg/m3 préviendrait
1 296 décès prématurés chaque année (dont 405 d’origine
cardio-vasculaire et 109 d’origine respiratoire).
Un modèle pour mieux communiquer les résultats d’Apheis aux décideurs
politiques
A titre de rappel, le programme Apheis cherche à répondre aux besoins
en information des individus et des organismes concernés par l’impact
sur la santé de la pollution atmosphérique en Europe, en particulier
ceux qui influencent et décident des politiques dans ce domaine aux
niveaux européen, national, régional et local.