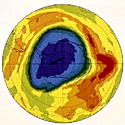 |
Trou d'ozone printanier en Antarctique, le 7 octobre 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994. Ces cinq cartes ont été réalisées à partir des informations obtenues par le TOMS de la NASA (Total Ozone Mapping Spectrometer), installé à bord du satellite américain Nimbus 7. Bien qu'une comparaison basée sur le même jour, d'année en année, soit peu significative, la dynamique du trou d'ozone s'étendant sur 1 à 2 mois, ces cartes traduisent cependant bien la tendance moyenne générale observée de l'augmentation de la superficie et de l'intensité du trou d'ozone.
|
|
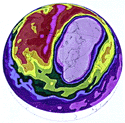 |
|
|
 |
La terre vue par
METEOSAT (canal infrarouge, la terre chauffée par le soleil apparaît
en sombre). |
|
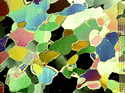 |
Lame mince d'une glace prélevée à Vostok (Antarctique) à 2 541 mètres de profondeur, vue en lumière polarisée. Les études menées en Antarctique et au Groënland sur le comportement mécanique de la glace offrent de multiples applications, en particulier en paléoclimatologie, mais aussi en science des matériaux et pour la conception de nouveaux brise-glace. | |
 |
Carottage en
Antarctique, au site de Vostok,
mené essentiellement dans le cadre d'une coopération Franco-Russe élargie
par la suite aux Etats-Unis. Les forages profonds dans la glace posent des problèmes spécifiques, il faut utiliser un fluide pour éviter la fermeture du trou et contrôler de nombreux paramètres à distance. Une campagne nécessite le transport de dizaines de tonnes à des centaines de kilomètres des stations d'appui côtiers, dans un milieu particulièrement inhospitalier. A la station Vostok, située à 3500 m d'altitude, la température moyenne annuelle est de - 56° C. En 1999, le forage atteint 3600 m de profondeur et s'arrête au-dessus d'un lac de la taille du lac Ontario. Les archives (climat et composition de l'atmosphère) remontent ainsi à 400 000 ans. |
|
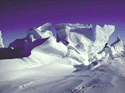 |
Sous l'effet des
courants océaniques et du vent, la banquise se brise: les plaques de
glace se chevauchent pour former ces amas de glace pouvant atteindre
plus de 10 m d'épaisseur. Ces "crêtes de pression" (pressure
ridges) sont des barrières souvent infranchissables pour les
bateaux brise-glace. (février 1988). |
|
 |
Récupération d'une carotte de névé à l'aide d'un carottier électromécanique. Mission Eurocore à Summit (Groenland) en juin-juillet 1989. | |
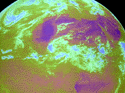 |
Image en fausses couleurs, donnant approximativement le flux thermique émis, obtenue à partir des données Météosat dans les canaux infrarouges "fenêtre" et "vapeur d'eau" (12/06/79, 11 h T.U.). L'échelle va du bleu clair, correspondant à des nuages élevés très froids, au violet, les points les plus chauds du Sahara. | |
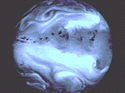 |
Moitié du globe
terrestre, satellite METEOSAT (ESA), canal vapeur d’eau. Cette image du globe terrestre portant sur l’Afrique et l’Europe (invisible ici) montre la contenance en vapeur d'eau de l’atmosphère. Il faut noter qu’il s’agit ici seulement d’eau sous forme vapeur, c'est-à-dire non condensée : l’eau en gouttes ou sous forme de glace n’est pas prise en compte. Les zones apparaissent d’autant plus claires qu’elles sont chargées en humidité. L’atmosphère au dessus des déserts africains est donc excessivement chargée en humidité (bleu clair), alors que l’eau des nuages équatoriaux est condensée et glacée en altitude (bleu foncé). On peut remarquer en haut la forme caractéristique en hélice d’une dépression. Cette image, fournie chaque jour à midi par le satellite, est très utilisée en météorologie. LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN |
|
 |
Gonflage d'un
ballon principal stratosphérique pour l'étude de la couche d'ozone.
Aire-sur-l'Adour (Landes). |
|
| LABORATOIRE
D'ETUDES
ET DE RECHERCHES EN TELEDETECTION SPATIALE (LERTS) - TOULOUSE © CNRS/CNES
|