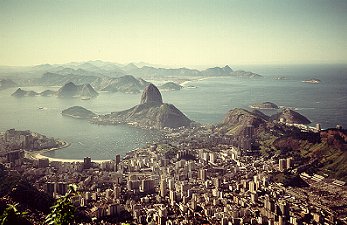Contexte général :
Au départ, quand les N.U. ont convoqué la Conférence de Stockholm, en
1968, le but de celle-ci était de créer une prise de conscience du
public des problèmes environnementaux. Trois ans plus tard, quelques
mois avant la Conférence, Mr. W. Bassow (Senior Public Affairs Officer
de la CNUEH) déclarait que ceux-ci n’avaient plus besoin de publicité.
En conséquence, l’Assemblée Générale des N.U. déclara que la Conférence
devrait être orientée vers l’action, et que des décisions devraient
être prises pour traiter les problèmes qui seraient discutés à
Stockholm.
Un plan d’action, composé de trois parties, fut alors préparé
par le Secrétariat de la Conférence :
- la Déclaration sur l’Environnement Humain
- la mise en place d’un système global de monitoring ("Earthwatch")
- la mise en place d’une unité, au sein de l’organisation des N.U.,
concernée par l’environnement (le futur UNEP)
Un des problèmes majeurs de la Conférence fut les divergences de vue
existant entre les pays du Nord et ceux du Sud. En effet, pour les pays
industrialisés, le concept de la gestion internationale des ressources
offrait les espoirs de voir apparaître une solution aux problèmes de
pollution. D’autre part, les pays en développement considéraient que
la pollution était un problème de pays riches, qui ne pourrait être
traité dans leur pays qu’une fois les autres problèmes résolus.
"La Conférence de Stockholm de 1972 ne
fut pas saluée par l’enthousiasme unanime de tous les Etats en développement,
loin de là. D’aucuns voyaient dans les problèmes d’environnement
une réaction contre les pollutions, essentiellement industrielles, et
ne se sentaient donc pas concernés. D’autres craignaient que les
fonds nécessaires pour améliorer l’environnement ne soient prélevés
sur les disponibilités - déjà insuffisantes - destinées aux développements.
Enfin, tous ou presque, estimaient qu’en eux-mêmes ils étaient en
tout cas trop pauvres pour participer au nouveau mouvement"
Une réunion de préparation organisée par les N.U. se tint à
Founex en Suisse en 1971 et parvint à réconcilier quelque peu les
avis. A cette occasion, les pays du Nord admirent la proposition des
pays du Sud selon laquelle "le manque de développement pouvait être
un facteur de dégradation environnementale, au même titre que le développement".
L’agenda de la conférence se présentait en 6 points:
· les problèmes environnementaux des établissements humains
· la gestion des ressources
· l’identification et le contrôle des polluants de portée
internationale
· les aspects sociaux, économiques, informationnels et éducationnels
de l’environnement
· l’environnement et le développement
· les problèmes organisationnels de l’établissement d’une
nouvelle structure aux N.U.
Déclaration de la Conférence des
Nations-Unies sur l’environnement :
La Déclaration adoptée par la Conférence de Stockholm reflète le
consensus politique atteint en ce qui concerne les relations entre
l’environnement et le développement. Elle contient 26 principes
"qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en
vue de préserver et d’améliorer l’environnement" (Déclaration,
préambule)
Le préambule reconnaît que les différentes activités humaines
provoquent des dommages à l’environnement. On y trouve notamment:
· l’idée que "l’homme est à la fois créature et créateur
de son environnement et que "les deux éléments de son
environnement, l’élément naturel et celui qu’il a lui même créé,
sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses
droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même" (Préambule
§ 1) On trouve plus loin, dans le paragraphe consacré à la
population, l’affirmation que "les hommes sont ce qu’il y a de
plus précieux au monde" (préambule, § 5)
· la reconnaissance du fait que "dans les pays en voie de développement,
la plupart des problèmes de l’environnement sont causés par le
sous-développement". En conséquence, "les pays en voie de développement
doivent orienter leurs efforts vers le développement, en tenant compte
de leurs priorités et de la nécessité de préserver et d’améliorer
l’environnement" (Préambule § 4)
· l’idée que la conservation de l’environnement est primordiale
pour l’humanité, pour les générations présentes et à venir (Préambule,
§ 6)
"(…) Défendre et améliorer l’environnement pour les générations
présentes et à venir est devenu pour l’humanité un objectif
primordial, une tâche dont il faudra coordonner et harmoniser la réalisation
avec celle des objectifs fondamentaux déjà fixés de paix et de développement
économique et social dans le monde entier" (préambule, § 6)
· la mise en évidence de l’importance de la participation des différents
acteurs de la société pour façonner l’environnement futur de
l’humanité et la nécessité de coopération entre les pays pour préserver
et améliorer l’environnement (Préambule, § 7)
"Pour que ce but puisse être atteint, il faudra que tous, citoyens
et collectivités, entreprises et institutions, à quelque niveau que ce
soit, assument leurs responsabilités et se partagent équitablement les
tâches. Les hommes de toutes conditions et les organisations les plus
diverses peuvent, par les valeurs qu’ils admettent et par l’ensemble
de leurs actes, déterminer l’environnement de demain. (…) (Préambule,
§ 7)
Parmi les 26 principes, on retrouve:
· les droits des êtres humains à un environnement viable et la
responsabilité de l’homme vis-à-vis de l’environnement (Principe
1)
· les principes 2, 3, 4 et 5 soulignent également la responsabilité
de l’homme dans la préservation de la nature et l’exploitation des
ressources renouvelables et non renouvelables, qui est liée à la
planification pour le développement économique (principe 2)
· Les principes 6 et 7 abordent les problèmes de rejets de matières
toxiques ou d’autres matières et de la pollution des mers.
· Les principes 8 à 17, pour une grande partie basés sur les
conclusions de la réunion de Founex, suggèrent différents moyens et
possibilités d’intégrer les préoccupations de développement et
d’environnement. Ces principes, à l’origine, avaient pour but de répondre
aux préoccupations des pays en voie de développement qui craignaient
que les actions environnementales mises en place à Stockholm entravent
leur développement économique et social.
· Le principe 18 traite des contributions des sciences et techniques
"pour déceler, éviter ou limiter les dangers qui menacent
l’environnement et résoudre les problèmes qu’il pose".
· Le principe 19 recommande la diffusion de l’éducation à
l’environnement.
· Le principe 20 souligne l’importance du transfert d’informations
et des données d’expérience, ainsi que des techniques intéressant
l’environnement, vers les pays en voie de développement.
· Le principe 21 contient deux concepts importants: d’une part, la
souveraineté des Etats par rapport à l’utilisation de leurs
ressources et d’autre part, le devoir des états de ne pas causer des
dommages à l’environnement à l’extérieur de leur frontière.
· Le principe 22 souligne le devoir des Etats à coopérer pour développer
des règles de responsabilité internationale et d’indemnisation des
victimes de la pollution ou d’autres dommages écologiques provoqués
en dehors des frontières par les activités des Etats dans leur propre
pays.
· Le principe 23 introduit le fait que les normes doivent être
relatives aux capacités de chacun.
· Le principe 24 recommande la coopération internationale en ce qui
concerne les questions internationales se rapportant à la protection et
à l’amélioration de l’environnement.
· Le principe 25 traite le rôle des organisations internationales dans
la préservation et l’amélioration de l’environnement.
· le principe 26 recommande l’élimination et la destruction des
armes nucléaires
Documents résultants :
Deux documents sont issus des travaux de l’UNCHE:
· la Déclaration de la Conférence des Nations-Unies sur
l’environnement - Declaration of the UN Conference on the Human
Environment - de caractère juridiquement non contraignant
· le Plan d’Action pour l’environnement - Action Plan for the Human
environment
Plan d’Action pour l’environnement :
Ce plan contient 109 recommandations, divisées en 5 grands thèmes:
· Aménagement et gestion des établissements humains en vue
d’assurer la qualité de l’environnement (Recommandations 1 à 18)
· Gestion des ressources naturelles au point de vue de
l’environnement (Recommandations 19 à 69)
· Détermination des polluants d’importance internationale et lutte
contre ces polluants (A. La pollution en général, B. La pollution des
mers, Recommandations 70 à 94)
· Aspects éducatifs, sociaux et culturels des problèmes de
l’environnement et question de l’information (Recommandations 95 à
101)
· Développement et Environnement (Recommandations 102 à 109)
Dans ce chapitre, se traduit de nouveau le consensus politique sur le
problème des relations entre l’environnement et le développement.
Ces recommandations envisagent notamment des mesures pour protéger les
intérêts commerciaux des pays en voie de développement dans le
contexte des politiques environnementales, ainsi que le transfert de la
technologie environnementale (recommandations 103 et 108) et le besoin
de procurer des ressources supplémentaires pour financer des actions
environnementales internationales (recommandations 107 et 109)