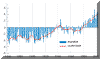L'effet de serre est un phénomène naturel, indispensable à la vie
sur Terre et qui assure une température moyenne de +15°C environ au lieu
de -18 °C.
La Terre reçoit la majeure partie de son énergie du soleil, une partie est
absorbée par la Terre et une autre renvoyée sous forme d'infrarouges. Le
rayonnement infrarouge réemis est en partie intercepté par les gaz à
effet de serre de l'atmosphère terrestre et le reste est renvoyé vers
l'espace.
Ainsi, la vapeur d'eau, le méthane, le dioxyde de carbone, le protoxyde
d'azote et l'ozone notamment, contribuent à piéger l'énergie renvoyée,
augmentant la température moyenne de la Terre. En effet, ce sont les gaz à
structure polyatomique (au moins 3 atomes) qui retiennent le rayonnement
infrarouge au contraire des molécules diatomiques (99% de l'atmosphère)
qui ont une structure trop simple. Notons ainsi que les nuages participent
à l'effet de serre en fonction de leur densité.
Les températures moyennes du globe (mesurées à 2 m au-dessus du sol sous
abri) sont de : +15,1 °C en moyenne (régions polaires : -20°C, tempérées
+11°C, équatoriales : +26°C).
Sur Mars où l'atmosphère est tenue et donc l'effet de serre absent, la
température moyenne est de -50°C. Sur Vénus, où l'atmosphère est trés
chargée en gaz carbonique, la température moyenne est de +420°C. Nous
comprenons donc que les concentrations en gaz à effet de serre (GES) sur
Terre ont permis l'apparition des formes de vie que nous connaissons qui
sont sensibles aux températures.
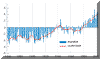
Evolution des températures moyennes mondiales de
1861 à 2003. En ordonnée, se trouvent les écarts de températures en °C
par rapport aux normales calculées pour la période 1961-1990.
L'élévation de température depuis le début des années 1980 est
notable tout comme les records des premières années du XXIème siècle.
Source : Unité de recherche climatique, University of East Anglia and
Hadley Centre, The Met Office, Grande-Bretagne - 2004
Une grande partie de la communauté scientifique est unanime : l'aggravation
de l'effet de serre est principalement à l'origine du changement climatique
en cours qui représente "une perturbation anthropique dangereuse du
système climatique". En effet, "de toute évidence, le climat
de la Terre a évolué à l'échelle régionale et mondiale depuis l'époque
préindustrielle" (GIEC, 2001).
Ceci entraîne des répercussions multiples sur l'écosystème
de la Terre comme la multiplication des anomalies climatiques.