 |
|
Face au naufrage imprévisible
toujours menaçant, l’homme a multiplié les recours.
La diversité des formes d’intercession, invocation de
la Vierge Marie et des saints patrons, attestent de la
force de l’espérance dans l’effroi. Les nombreux
ex-voto dans les chapelles témoignent de la ferveur des
populations. L’appel aux équipes de sauvetage en mer
en est une forme contemporaine. L’intervention de l’État
pour améliorer la sécurité en mer ou la réglementation
juridique apportent des réponses plus rationnelles.
|
| |
|
Entre 1824 et 1962, il
y aurait eu de par le monde environ 13 000 naufrages,
soit un peu moins de cent par an, et 1,7 million de
victimes. Au beau milieu du XIXe siècle,
certains auteurs évoquent même la cadence d’un
naufrage par jour. Les données un peu solides mais
fragmentées que l’on possède pour la période antérieure
soulignent la fréquence de la catastrophe. Entre 1665
et 1769, la célèbre Compagnie hollandaise des Indes
orientales (la V. O. C) perdit ainsi 5,8 % de sa flotte
et sa rivale française 6 %. Plus précisément encore,
ce sont 3,4 % de l’ensemble des navires armés à
Nantes entre 1700 et 1792 pour les îles d’Amérique
qui sombrent. Pourtant, au-delà des données chiffrées,
il faut rechercher à la fois les constantes qui président
au naufrage mais, plus encore peut-être, tenter
d’appréhender les réactions des hommes et des femmes
confrontés à ce qui reste pour eux une expérience
unique et souvent ultime.
|
|
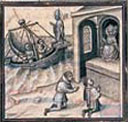
|
|
Les
moyens de conjuration
Les
ex-voto marins, ces représentations imagées et mémorielles
de l’événement, tentent de faire sentir au
spectateur l’atmosphère d’impuissante frayeur à
laquelle se heurte un équipage qui va se perdre. Bien
d’autres supports, iconiques ou écrits, rendent le
ciel, les orages, la foudre, le brouillard, responsables
du naufrage annoncé. En fait, il semble que la violence
des éléments n’entre que pour une part médiocre, en
tout cas minoritaire, dans ces infortunes maritimes au
regard des responsabilités humaines. L’incompétence
des navigateurs (capitaines ou pilotes), renforcée au
moins jusqu’aux années 1760-1780 par de piètres
instruments de mesure et une cartographie approximative,
pèse lourdement dans l’origine des catastrophes tout
comme les séquelles des combats militaires et des
mutineries. Toutefois cette partition des responsabilités
est un peu factice puisque les bourrasques tropicales
entre mai et octobre, comme les dépressions de novembre
à février sur les mers européennes, aggravent singulièrement
les conditions incertaines de navigation imputables aux
hommes.
Mais si la peur de trépasser à l’occasion d’un
naufrage est si redoutée aux temps modernes, c’est
surtout parce que la mort en mer semble dénaturée,
puisque la disparition des corps dans ce royaume
d’abandon infernal n’admet aucune trace ultérieure.
Le cadavre englouti exclut toute topographie du
souvenir. La disparition des naufragés
s’apparente-t-elle à une "vraie mort", ne
favorise-t-elle pas l’errance infinie des âmes et les
corps qui ne tarderont pas à servir de proie aux
monstres marins pourront-ils participer à la résurrection
de la chair ? Ce sentiment de déréliction partagé par
les chrétiens de toute obédience se trouvait accentué
dans la confession catholique par la privation probable
des derniers sacrements faute d’aumônier, faute de
temps aussi pour se préparer.

|
| |
|
Avant d’aller
affronter la tempête ou le naufrage, les gens de mer
recouraient en effet à un ensemble de gestes, souvent
extrêmement anciens, qui avaient pour fonction
d’appeler les bénédictions du ciel plus encore sur
le navire que sur l’équipage. Les constructeurs
navals n’hésitaient pas à figurer la proue sous la
forme d’un animal totémique, d’une divinité
fantastique, voire à l’effigie d’un saint. Le
lancement du bateau s’accompagnait de rites de
conjuration. L’immolation d’un mouton blanc, puis
l’écoulement de son sang sur le pont afin que la mer
n’exige plus d’autre sacrifice, enfin l’exposition
de sa peau à la proue du navire sont attestés dans les
ports italiens au moins jusqu’au XVe siècle.
Répondant à la plus proche orthodoxie chrétienne des
bénédictions, le navire neuf, en recevant son nom, bénéficiait
d’un rituel bien spécifique. En revanche, il est
souvent assez délicat d’apporter des conclusions
assurées sur le choix des saints protecteurs en
s’appuyant sur la seule onomastique navale. En effet
le nom des bâtiments de pêche ne fait bien souvent que
doubler le patronyme du patron propriétaire et celui de
nombreux navires de commerce est fréquemment choisi par
les seuls armateurs et non par les navigants.
Tout en participant aussi de cette volonté
bienfaisante, la bénédiction de la mer est, sur
l’ensemble des littoraux, beaucoup plus récente et
longtemps beaucoup moins répandue en dépit de quelques
mentions dès le XVe siècle
du côté d’Ostende ou de Narbonne. C’est surtout au
XIXe et singulièrement
après 1840-1860 qu’un tel événement se multiplie,
spécialement dans les ports de pêche, Paimpol,
Dunkerque, Douarnenez, associant aux marins partant vers
les périls la population locale et les foules
touristiques déversées par le chemin de fer.
|
|

|
|
Le
recours au surnaturel
Face à
ces dangers corporels et spirituels qui constituent
l’essentiel de la dramaturgie océane, les hommes ne
se sentent pas totalement démunis. Se prémunir contre
cette fortune de mer c’est d’abord distinguer deux
moments qui, dans la réalité de la catastrophe,
peuvent s’entremêler ou se succéder à intervalles
irréguliers. La menace croissante de la vague conduit
les personnes embarquées à lutter et à prier selon
leur fonction, leur situation propre, leur état
d’esprit. Dans plusieurs relations, souvent reprises
par la littérature, c’est bien la sauvegarde physique
et matérielle qui prime. C’est peut-être Herman
Melville qui, dans Moby Dick, traduit le plus
justement ce sentiment dominant : "[Lorsque] le
Pequod eut ses trois mâts fauchés dans un typhon
du Japon […] n’as-tu pas alors pensé à la mort et
au Jugement ? Écoutez, cria Péleg, je me rappelle.
Penser au Jugement, à la mort ? Non ! On n’avait pas
le temps de penser à la mort dans ces moments-là.
C’est à la vie que le capitaine Achab et moi pensions
alors et à comment nous sauver tous."
Dans nombre de récits domine exclusivement le recours
ultime au surnaturel ; ici et là à travers quelques
traces non effacées de croyances païennes, plus sûrement
grâce aux référents culturels appris dès l’enfance
que propose la foi chrétienne. Mais l’époque d’Érasme
et de Rabelais est celle des hésitations
confessionnelles, celle d’une volonté de rupture avec
des pratiques tenues pour superstitieuses. Le naufragé,
par désespoir, semble mobiliser toute la cour céleste.
On implore son saint patron, celui de sa paroisse
d’origine, ceux en qui les marins ont mis toute leur
confiance et Marie en tout premier lieu. Le danger
devient aussi l’occasion d’un marché
donnant-donnant, aboutissant à une promesse, à
l’accomplissement d’un vœu en cas de sauvegarde. |
 |
|
L’impression générale
qui ressort des "naufrages catholiques" est
celle d’une sorte de confusion spirituelle répondant
en quelque sorte au désordre de la nature, d’un
foisonnement des recours accentué ici et là par la
bousculade qui préside à la confession auriculaire
lorsqu’un prêtre se trouve à bord. Le climat, en
apparence, semblait tout autre lors des "naufrages
protestants". L’abandon radical – au moins en
théorie – du culte des saints et de leur possible
intercession, la condamnation sévère des
"superstitions" romaines, images pieuses,
cierges, pèlerinages, éventuelles reliques et autres
eaux bénites, renvoyaient le croyant à un strict face-à-face
avec Dieu dans les moments d’allégresse comme dans
les temps de souffrance.
|
|

|
|
Refuser
la fatalité de la mort
Sans que
l’on sache vraiment si les navigateurs réformés en péril
n’invoquaient pas en silence les saints de
l’ancienne religion, on remarque, à l’inverse, que
plus on avance dans le cours du XVIIIe et
du XIXe siècle, moins les
récits de naufrage ou même les ex-voto peints se réfèrent
aux intercesseurs célestes. C’est en particulier le
cas d’officiers qui relatent la teneur de leur oraison
adressée en priorité à l’Être suprême. Cette
discrétion prononcée à l’endroit du Dieu des chrétiens,
auquel se substituent un ciel dépeuplé et une idée
sublime, se trouvait déjà marquée à la veille de
1789 en France puisque, dans son récit de naufrage, La
Monneraye ne signale aucune attente spirituelle de la
part des victimes et La Pérouse, après le naufrage de
trois canots de son expédition en Alaska en 1786, fait
inscrire sur le cénotaphe : "Qui que vous soyez, mêlez
vos larmes aux nôtres." Face au naufrage, quelques
documents semblent indiquer une autre partition des
attitudes spirituelles, non plus sociale ni même tout
à fait confessionnelle mais géographique et
culturelle. Après les années 1750, les marins des
nations "éclairées", France ou Angleterre,
refusent eux aussi plus fermement la fatalité de la
mort, certes soutenus par "l’assistance de la
divinité" en se battant jusqu’au bout tandis
que, venus de contrées encore archaïques, "les
Russes et les Espagnols, désespérant du salut commun,
se jettent à genoux, les mains tendues vers le ciel,
ils supplient Dieu de leur faire grâce d’une bonne
mort et lui demandent le pardon de leurs péchés".
 
|
|
 |
Les recours traditionnels ne s’évanouissent pas
pour autant. Même les ex-voto peints, dont le ciel est
devenu vide, restent l’expression d’un vœu fervent
; les prières des naufragés du XIXe siècle,
celles des pêcheurs, en particulier, s’adressaient
aux saints tutélaires et peut-être plus encore à
Marie dans ce siècle d’hyperdulie triomphante. La
protection contre ces tragédies lointaines, soudaines,
redoutables, se trouvait encore portée par la foi.
|
|
|